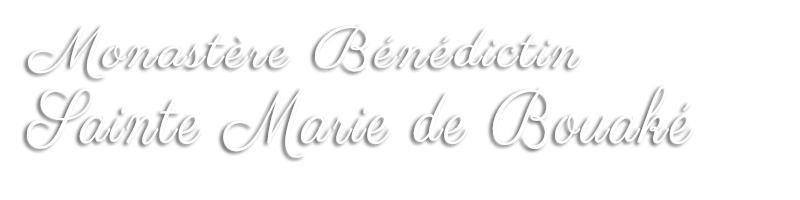L’une des sources de Benoît (480-547) est Pachôme (287-347) qui a vécu en Égypte.
Sur ce point, Pachôme a davantage développé sa pensée et il nous donne des repères fondamentaux pour répondre à cette question.
Pour Pachôme, il est difficile pour un moine qui vit seul d’accueillir les hôtes qui viennent à lui, difficile aussi de gérer les relations avec la famille. Le danger est grand pour le solitaire de perdre sa vie monastique s’il vit toutes ces solidarités ; en revanche, cela est rendu possible par la vie communautaire.
Le tissu communautaire permet de vivre la distance pour sauvegarder la vie monastique et aussi d’avoir une vraie communion grâce à l’implication de toute la communauté.
Lorsqu’un membre de la famille se présente au monastère, le portier entre d’abord en contact avec le père du monastère, alors est rendue possible la rencontre entre le moine et sa famille avec la présence d’un tiers.
Ce processus peut apparaître lourd, mais il engage trois valeurs : la liberté du frère (le respect de son propre cheminement et de sa liberté intérieure) ; l’expérience par le frère que son lien avec sa famille d’origine concerne et intéresse désormais toute la communauté ; la découverte par la famille de la communion monastique qui lie leur parent à d’autres disciples du Christ. La présence d’un frère à ses côtés, témoigne aussi de cette nouvelle solidarité.
Lorsque les parents apportent de la nourriture, le frère appelle le portier qui reçoit le don. À travers ce geste, s’exprime, certes, la fidélité à l’engagement du frère à la « non propriété », mais surtout la reconnaissance du nouveau lien qui lie le moine à sa communauté.
Lorsque la nourriture apportée est celle que les frères mangent habituellement au monastère, elle est donnée aux frères malades, sans doute en supplément. En revanche, lorsqu’il s’agit de friandises ou de fruits, le frère en reçoit une part et le reste est apporté aux frères malades.
Cette distinction des dons et la manière qu’a Pachôme d’en parler est instructive : lorsque le don est ordinaire, il y a tout lieu de penser qu’il s’adresse à tous. Nous avons ici le cas d’une famille qui comprend la situation religieuse du frère et offre à la communauté ce qu’elle est accoutumée à manger ; ce don est apporté aux frères les plus démunis de la communauté auxquels l’on donne habituellement un supplément.
Dans le cas de dons plus « extraordinaires », la joie du frère est aussi celle de la famille qui offre, d’où l’accueil particulier réservé à ce don et l’autorisation donnée au frère d’en prendre une part et de la manger. Les frères malades reçoivent la part restante.
Pachôme demande que ce don soit un échange et que la famille reçoive en retour de la nourriture des moines : « des choux, des pains ou un peu de légumes ». Par cet échange de nourritures, l’accueil devient un repas où chacun apporte ses mets. Cette rencontre manifeste la communion entre la communauté monastique tout entière et la famille du moine.
Toutes ces précisions sont une invitation à entrer dans la délicatesse toute monastique de la rencontre et de l’accueil.
Les aliments offerts par la famille et qui sont consommés avec du pain, donc avec un aliment monastique, sont mangés par le frère qui a reçu sa famille avec les frères de l’infirmerie, ensemble. Ce repas, ce partage de nourriture honore, en quelque sorte, le frère qui peut vivre ainsi un temps de fraternité avec les plus vulnérables de sa communauté.
Il arrive parfois que le frère lui‑même est conduit à rendre visite à un parent malade. Il ne le décide pas seul. Le portier avertit le père du monastère qui, choisit un membre de la communauté pour accompagner le frère et déterminer la quantité de nourriture qu’il faudra leur remettre, c’est‑à‑dire définir la durée de leur séjour.
Pachôme n’envisage pas ici un refus de la demande formulée par la famille, mais bien plutôt la manière qu’aura la communauté d’accompagner le frère dans sa démarche. Là aussi, la communauté tout entière se rend attentive à la souffrance de la famille du frère qui n’est pas envoyé seul mais avec un compagnon.
Chaque monastère bénédictin a sa manière propre de répondre aux demandes des familles, mais toutes sont attentives à vivre une communion profonde avec les familles qui ont partie liée avec la communauté parce qu’elles ont accepté de lui donner l’un de ses fils. Toutes les communautés sont aussi attentives à partager et à accompagner les peines et les joies familiales du frère, tout en veillant à ce qu’un trop fort attachement ne le sépare pas de son appel à demeurer au monastère, au milieu de ses frères, en présence du Christ.
Lire aussi
Le mot de bienvenue
Bienvenue au monastère Sainte-Marie ! Akwaba ! Ala ka héré b’i fé ! Le Monastère Sainte-Marie de Bouaké est situé à proximité de la ville de Bouaké (environ 1 500 000 habitants, seconde ville de la Côte d’Ivoire) ; il a été fondé en 1960 par les moines de Toumliline au Maroc…
Histoire
L’histoire du monastère Sainte-Marie de Bouaké Le monastère bénédictin Sainte-Marie de Bouaké est un prieuré de l’Ordre de Saint-Benoît (480-547), l’Ordre le plus ancien de l’Église catholique (VIe siècle). L’Ordre bénédictin est subdivisée en plusieurs Congrégations ; notre monastère est membre de la Congrégation Subiaco Mont-Cassin. L’histoire de notre communauté…
Comment devenir moine ?
Thomas Merton (1915-1968), moine cistercien-trappiste américain, dit : « un moine doit être une personne bien équilibrée. Selon le mot de saint Benoît, il doit chercher Dieu sincèrement, être capable de vivre dans un groupe, simplement et charitablement. Il doit aussi avoir des vertus solides, une aptitude à servir avec…
La journée du moine
La journée du moine au monastère sainte-marie de Bouaké Combien de temps les moines consacrent-ils à la prière ? Ont-ils d’autres activités ? Office des Laudes 01 Messe 02 Messe 03 Chapitre 04 Travaux 05 Travaux 06 Office 07 Office de sexte 08 Office des Vêpres 09 Travaux 10 Repas…
La fonction du prieur
RÈGLE DE SAINT BENOÎT chapitre 2 Les qualités que l’abbé doit avoir 1. L’» abbé*, celui qui est digne d’être à la tête du » monastère*, doit toujours se rappeler le nom qu’on lui donne. Il doit prouver par ses actes* son nom de « supérieur ». 2. En effet, au regard…
La fonction du Maître des novices
Le Maître des Novices : Du père Abbé, il reçoit la charge des âmes de ceux qui frappent à la porte du monastère et qui souhaitent devenir moines. Il rend compte à l’Abbé de leur désir constant de chercher Dieu. Avec son aide, les stagiaires, les postulants, les novices approfondissent…
La fonction du Cellérier
RÈGLE DE SAINT BENOÎT chapitre 31 Les qualités que le cellerier doit avoir 1. Comme » cellérier* du » monastère*, on choisira dans la communauté* un frère sage et de caractère mûr, sobre dans le boire et le manger. Il n’est pas orgueilleux, ni agité, ni injuste, ni lent, ni dépensier, 2.…
Rapport au monde
Rapport au monde Extraits de la Lettre à Diognète Tu veux donc savoir, illustre Diognète, quelle est la religion des chrétiens. (…) J’approuve ton désir, Diognète, et je demande à Dieu, qui seul donne la parole et l’intelligence, de mettre dans ma bouche le langage le plus propre à changer…